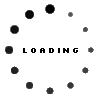Redécouvrir sa ville : l’essor des “staycations” séduit le monde urbain
Les staycations transforment le tourisme urbain. Séjours courts, hôtels locaux et expériences inédites font redécouvrir sa propre ville autrement.
Le phénomène des staycations, contraction de “stay” et “vacation”, s’impose dans le tourisme contemporain. Le principe : voyager sans partir loin, en profitant de son propre environnement comme d’une destination. Né après la crise de 2008 et amplifié par la pandémie de 2020, ce concept séduit pour son accessibilité, son impact écologique limité et son intérêt économique pour les acteurs locaux. En 2025, plusieurs grandes métropoles comme Paris, Londres, Tokyo ou Montréal constatent une forte hausse des réservations hôtelières de proximité. Les plateformes de réservation enregistrent jusqu’à +30 % de séjours intra-muros par rapport à 2019. Les staycations redéfinissent le rapport au voyage : ils valorisent la curiosité locale, la détente et le confort, tout en soutenant les commerces et établissements culturels. Ce mouvement révèle une tendance durable, fondée sur la recherche d’un équilibre entre évasion et proximité.
Le concept d’une évasion sans départ
La staycation repose sur une idée simple : prendre des vacances chez soi, ou à quelques kilomètres seulement. L’objectif n’est pas de rester enfermé, mais de regarder sa ville autrement, en changeant de cadre et de rythme. Cette approche, popularisée aux États-Unis dans les années 2000, s’est largement démocratisée après la pandémie, quand les restrictions de déplacement ont encouragé les habitants à explorer leurs environs. Aujourd’hui, elle séduit un public varié : familles cherchant une parenthèse sans logistique complexe, couples souhaitant un week-end de détente, ou actifs voulant déconnecter sans prendre l’avion.
Les staycations combinent souvent hébergement local, gastronomie, bien-être et découverte culturelle. À Paris, par exemple, les hôtels quatre et cinq étoiles proposent des formules “détente urbaine” incluant spa, brunch, et nuit sur place. À Tokyo, des offres de “micro-retreats” permettent aux citadins de se ressourcer dans des ryokans modernes à Shinjuku ou Ginza, sans quitter la capitale. Le principe : transformer un environnement familier en terrain d’exploration.
Le succès commercial d’un tourisme de proximité
La croissance du tourisme local est désormais mesurable. Selon l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), le marché des séjours de proximité a progressé de 27 % entre 2019 et 2024, soit plus vite que les voyages internationaux. Les chaînes hôtelières ont adapté leurs stratégies : Marriott ou Accor développent des forfaits “Stay & Relax” destinés à une clientèle locale, tandis que des plateformes comme Staycation.com ou Weekendesk ciblent directement les résidents urbains.
En France, le phénomène a trouvé un terrain favorable. D’après une étude de l’INSEE (2024), près d’un tiers des séjours de courte durée concernent désormais des destinations situées à moins de 100 kilomètres du domicile. Ce modèle profite aux grandes villes, mais aussi aux zones périurbaines dotées d’offres culturelles ou gastronomiques attractives. Les hôtels y gagnent une clientèle complémentaire, souvent en basse saison, et les restaurateurs observent une hausse sensible des réservations week-end.
Le staycation est devenu un levier commercial à part entière : il fidélise une population locale, réduit la dépendance au tourisme international et encourage les circuits courts.
Les raisons d’un engouement durable
L’essor des staycations s’explique par plusieurs facteurs. D’abord, un changement de rapport au temps : beaucoup préfèrent multiplier les pauses courtes plutôt que de longues vacances lointaines. Cette approche modulaire correspond aux rythmes professionnels modernes, où les congés fractionnés sont plus faciles à gérer. Ensuite, le coût. Voyager localement réduit drastiquement les dépenses de transport, un atout majeur en période d’inflation. Selon une étude de Skyscanner, une famille de quatre économise en moyenne 40 % de budget en optant pour une escapade locale plutôt qu’un vol moyen-courrier.
Le facteur écologique pèse également. De plus en plus de citadins veulent limiter leur empreinte carbone sans renoncer à l’évasion. Une staycation permet de profiter du confort hôtelier ou d’une expérience gastronomique sans émissions liées à l’aviation. Enfin, l’aspect psychologique joue un rôle fort : il s’agit de “déconnecter sans partir”, de retrouver du plaisir dans le quotidien en changeant simplement de cadre.
Les réseaux sociaux renforcent cette tendance : le hashtag #staycation dépasse les 25 millions de publications sur Instagram en 2025, signe que cette forme d’évasion inspire et s’ancre dans les pratiques.

Le choix du bon cadre pour une staycation réussie
Pour profiter pleinement d’une staycation, le choix du lieu reste essentiel. L’idée n’est pas seulement de dormir ailleurs, mais de changer de perception. Dans une grande ville, cela peut signifier réserver une nuit dans un palace ou un boutique-hôtel au cœur d’un quartier qu’on fréquente rarement. À Londres, le Ned ou le Ham Yard Hotel accueillent une clientèle majoritairement locale les week-ends. À Paris, le Kimpton St Honoré ou le Molitor capitalisent sur leur spa et leurs terrasses.
Les expériences à thème se multiplient : ateliers de cuisine, séances de yoga en rooftop, circuits d’art urbain, dégustations dans des caves locales ou croisières fluviales. Le séjour peut aussi s’articuler autour du bien-être – spa, hammam, massages – ou de la gastronomie, en profitant de tables habituellement inaccessibles en semaine. Certains hôtels parisiens ou lyonnais proposent des offres incluant dîner gastronomique, nuitée et brunch, pour recréer un sentiment de déconnexion totale.
Pour ceux qui préfèrent une approche plus sobre, les locations saisonnières urbaines permettent d’explorer d’autres quartiers et de s’immerger dans une atmosphère nouvelle. Dans tous les cas, le critère clé reste la rupture symbolique avec la routine.
L’impact économique et social sur les territoires urbains
Les staycations génèrent des retombées économiques tangibles. Elles prolongent l’activité touristique hors saison et redistribuent la dépense vers les acteurs locaux. Un week-end d’hôtel, de restauration et de loisirs dans une grande ville représente en moyenne 400 à 600 euros de chiffre d’affaires, dont une part significative revient à des entreprises indépendantes. Les collectivités y trouvent un levier de dynamisation : davantage de fréquentation des musées, expositions ou sites historiques par les résidents eux-mêmes.
Socialement, le phénomène contribue à revaloriser le lien entre habitants et territoire. En redécouvrant leur patrimoine, les citadins perçoivent leur environnement avec un regard neuf. Cette appropriation renforce l’identité locale et encourage des comportements plus respectueux de l’espace urbain. Pour les hôteliers et restaurateurs, la clientèle de proximité présente aussi l’avantage d’une fidélité plus forte et d’une sensibilité accrue à la qualité de service. Le tourisme domestique devient ainsi un pilier stratégique, soutenu par les politiques de transition et de résilience post-pandémie.
Les perspectives d’un tourisme réinventé
L’essor des staycations révèle un changement structurel dans la manière de voyager. Face à la volatilité géopolitique, à l’urgence climatique et aux coûts énergétiques, le tourisme mondial tend vers la proximité et la durabilité. De nombreuses villes développent désormais des plans de tourisme local, avec des offres combinées hôtel-culture-restauration.
Les grands opérateurs s’y adaptent : Airbnb teste des expériences “Micro Trips”, Accor développe des “City Escapes” dans les capitales européennes, et certaines municipalités subventionnent les pass culturels pour inciter les habitants à consommer localement. Ce modèle inspire également les zones rurales périphériques, où de petites structures hôtelières capitalisent sur la clientèle urbaine des métropoles voisines.
Au-delà de la mode, la staycation traduit un besoin profond : ralentir, explorer autrement et se reconnecter à son environnement immédiat. Dans un monde où la mobilité redevient un luxe, apprendre à redécouvrir sa propre ville pourrait bien devenir la forme la plus authentique du voyage.
Les plus beaux hôtels du monde
Bienvenue sur notre site de présentation des plus beaux hôtels du monde. Ce site est réalisé par un collectif de voyageurs, le plus souvent voyageurs d’affaires, qui parcourent le monde. Le but de ce site est de vous présenter notre sélection des plus beaux hôtels que l’on retrouve en Europe, en Amérique et dans le reste du monde.
Notre sélection est totalement indépendante. Nous tenons compte des critères usuels de classification des hôtels comme le nombre d’étoiles, mais aussi d’autres critères tels que l’expérience globale de l’hôtel, l'environnement général et le critère très personnel de la "séductivité" de l'hôtel. C’est pour cela que certains hôtels, qui ne sont pas des 5*, peuvent être dans notre sélection des meilleurs hôtels du monde.
Vous avez une question ? Contactez-nous sur contact @ seoinside.fr
Retrouvez notre sélection des plus beaux et meilleurs hôtels du monde par géographie :
Afrique - Amerique Centrale - Amerique du Nord - Amerique du Sud - Asie - Caraïbes - Europe - Moyen Orient - Ocean Indien - Pacifique & Océanie