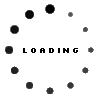L’Islande face au surtourisme quinze ans après Eyjafjallajökull
Quinze ans après l’éruption de 2010, l’Islande interroge son modèle touristique : flux record, sites saturés, fiscalité verte et pistes de quotas pour protéger son identité.
En résumé
Quinze ans après l’éruption d’Eyjafjallajökull, l’Islande récolte les fruits d’une visibilité mondiale, mais mesure les limites d’un essor rapide. Le pays a accueilli près de 2,3 millions de visiteurs en 2024 pour 380 000 habitants, avec une contribution du secteur autour de 8–9 % du PIB et plus de 30 000 emplois. Les tensions se concentrent sur le Sud et la péninsule de Reykjanes : Blue Lagoon a été évacué à plusieurs reprises en 2023-2025 et le Golden Circle (Þingvellir, Geysir, Gullfoss) enchaîne les pics de fréquentation. Les autorités ont rétabli une taxe touristique et discutent d’outils plus fins : modulation tarifaire selon la pression, gestion de la capacité et couloirs de circulation pour lisser les flux. Dans les bourgs comme Vík í Mýrdal, les réseaux et le logement subissent l’affluence. Un débat s’ouvre sur des quotas touristiques ciblés dans les sites les plus sensibles, afin de préserver l’expérience, la culture locale et l’environnement.
Le basculement post-2010 et l’ampleur des flux
L’éruption d’Eyjafjallajökull en 2010 a transformé l’Islande en destination de premier plan, avec un passage d’environ un demi-million de visiteurs en 2010 à plus de deux millions à partir de 2017. Le palier s’est confirmé après la pandémie : 2,26–2,30 millions de visiteurs en 2024, niveau proche des records historiques. La mécanique est claire : connectivité aérienne via Keflavík, marketing sur la nature « brute », et montée des courts séjours. La pression se concentre dans un rayon de 200 km autour de Reykjavík, sur des routes à deux voies et des parkings dimensionnés pour des volumes antérieurs.
La part économique et la vulnérabilité d’un petit marché
Le tourisme en Islande pèse autour de 8–9 % du PIB en 2024-2025, légèrement en-deçà des 10 % parfois avancés, mais il domine les recettes en devises et soutient environ 31 000 à 34 000 emplois selon les mois. Cet effet d’entraînement se double d’une fragilité : toute perturbation (éruption, change, ralentissement américain) se répercute instantanément sur l’hôtellerie, les guides, la location de voitures et la distribution. Dans une économie de petite taille, l’arbitrage entre croissance et soutenabilité devient central pour éviter la dépendance sectorielle.
Les sites sous tension et le risque de saturation
Les goulots se multiplient sur les icônes du Golden Circle. À Þingvellir, les compteurs d’Almannagjá mesurent 4 000 à 5 000 passages aux heures de pointe en été, avec un pic entre 10 h et 12 h. À Geysir et Gullfoss, la rotation des bus accentue les à-coups. Sur Reykjanes, Blue Lagoon a cumulé des fermetures préventives lors des épisodes éruptifs ; une fissure a, par exemple, atteint 1,2 km (1 200 m) au printemps 2025, entraînant évacuations et déviations routières. La densité de fréquentation dégrade l’expérience : files, contraintes de stationnement, usure des sentiers, et difficultés à maintenir des standards homogènes de sécurité et d’interprétation.

La fiscalité verte et les instruments de gestion de la demande
Le gouvernement a rétabli une taxe touristique nationale depuis 2024 : environ 600 ISK par nuitée à l’hôtel, 300 ISK au camping et 1 000 ISK par nuitée en croisière. L’exécutif étudie une modulation dite « feu tricolore » : tarif de fréquentation ajusté à l’état des milieux (vert/jaune/rouge) et à l’acceptabilité sociale. À cela s’ajoutent des « visitor fees » sur les sites, destinées à financer sentiers, passerelles, sanitaires et gestion des déchets. L’objectif est double : orienter la demande vers des créneaux moins saturés et dégager des ressources récurrentes pour l’entretien des sites naturels.
Le débat sur les quotas et la capacité écologique
Le mot d’ordre est de calibrer l’accès dans les zones les plus sensibles. Les gestionnaires évoquent, pour certains sites, des seuils journaliers, des créneaux réservables ou des parcours à sens unique. Des quotas touristiques existent ponctuellement ailleurs en Europe ; en Islande, ils sont envisagés de façon ciblée, comme outil d’ultime recours à côté de la tarification dynamique. L’expérience accumulée à Þingvellir (comptage temps réel), les protocoles d’évacuation sur Reykjanes et la réservation obligatoire à Blue Lagoon montrent que la régulation par l’horaire et la capacité peut atténuer les pics, sans couper le pays de son économie d’accueil.
Les effets collatéraux : logement, services et vie locale
L’essor des locations de courte durée a intensifié la pression sur le parc résidentiel de la capitale : parts élevées d’annonces dans certains quartiers, loyers en hausse et rotation plus rapide du parc meublé. Dans des bourgs très visités comme Vík í Mýrdal, les réseaux d’assainissement, la collecte des déchets et la circulation sont mis à rude épreuve en haute saison. Le tourisme médical et le bien-être pèsent peu en Islande, mais la demande pour les bains naturels et les « hot pots » modifie les usages des habitants, alimentant un débat sur la priorité donnée aux résidents dans les créneaux et tarifs.
La réponse des infrastructures et la dispersion géographique
Keflavík a accru sa capacité : extension de terminal et maillage de 90+ destinations à la belle saison. Mais la dispersion des flux reste insuffisante. Les autorités et Business Iceland promeuvent les régions du Nord et de l’Est, et les itinéraires plus longs comme la Ring Road (1 322 km), afin d’allonger la durée moyenne de séjour et de diluer la fréquentation. Des fonds nationaux cofinancent parkings perméables, passerelles en bois, signalétique multilingue et restauration de sentiers en matériaux locaux pour limiter l’érosion. Le bénéfice est triple : sécurité, confort de visite, et réduction de l’empreinte sur les sols volcaniques fragiles.
La sécurité volcanique et l’acceptabilité du risque
L’Islande n’est pas qu’une carte postale : c’est une île active. Sur la péninsule de Reykjanes, onze éruptions depuis 2021 ont rappelé la nécessité d’alertes, d’évacuations rapides et d’itinéraires de repli. Les gestionnaires de sites et d’hôtels ont perfectionné les procédures : sirènes, capteurs de gaz, barrières anti-lave, parkings relocalisés, navettes temporaires. L’aviation civile et ISAVIA ont aussi renforcé leurs plans d’urgence pour limiter les retards à Keflavík. La culture du risque devient un volet de la soutien du tourisme : informer sans dramatiser, et garantir des standards internationaux de sûreté.
La feuille de route : tarification, données et qualité de service
La soutenabilité repose sur trois leviers. D’abord, la tarification : étendre la modulation horaire et saisonnière, et ajuster les visitor fees au coût réel d’entretien. Ensuite, la donnée : compteurs anonymisés, prévision des flux, affichage de l’affluence en temps réel et incitations à la réservation hors-pointe. Enfin, la qualité : investir dans les toilettes publiques, les refuges de mauvais temps, la signalétique et la formation des guides. Pour l’hôtellerie, la priorité est de lisser l’occupation hors été et de renforcer les standards dans le moyen de gamme, notamment hors de Reykjavík, afin d’augmenter la dépense moyenne tout en réduisant la pression sur les « spots » saturés.
Les scénarios 2026-2030 : croissance maîtrisée ou plafond de verre
Si les arrivées dépassent 2,3–2,4 millions par an, l’Islande devra arbitrer : mieux répartir plutôt que croître à tout prix. Des objectifs mesurables peuvent guider l’action : diminuer de 20 % les pics horaires sur le Golden Circle, relever la part des nuitées en dehors du Sud-Ouest, porter à 50 % la part de visites réservées en créneau sur les sites sensibles, et stabiliser l’empreinte par visiteur. Le pays a l’avantage de la clarté : un territoire compact, des sites numérisés, une gouvernance réactive. Reste à inscrire ces choix dans un contrat social : préserver la culture locale, maintenir l’accès pour les Islandais, et offrir aux voyageurs une expérience plus fluide, mieux répartie et plus respectueuse des lieux.
LES PLUS BEAUX HOTELS DU MONDE est un guide indépendant.
Lire aussi:
Les plus beaux hôtels du monde
Bienvenue sur notre site de présentation des plus beaux hôtels du monde. Ce site est réalisé par un collectif de voyageurs, le plus souvent voyageurs d’affaires, qui parcourent le monde. Le but de ce site est de vous présenter notre sélection des plus beaux hôtels que l’on retrouve en Europe, en Amérique et dans le reste du monde.
Notre sélection est totalement indépendante. Nous tenons compte des critères usuels de classification des hôtels comme le nombre d’étoiles, mais aussi d’autres critères tels que l’expérience globale de l’hôtel, l'environnement général et le critère très personnel de la "séductivité" de l'hôtel. C’est pour cela que certains hôtels, qui ne sont pas des 5*, peuvent être dans notre sélection des meilleurs hôtels du monde.
Vous avez une question ? Contactez-nous sur contact @ seoinside.fr
Retrouvez notre sélection des plus beaux et meilleurs hôtels du monde par géographie :
Afrique - Amerique Centrale - Amerique du Nord - Amerique du Sud - Asie - Caraïbes - Europe - Moyen Orient - Ocean Indien - Pacifique & Océanie